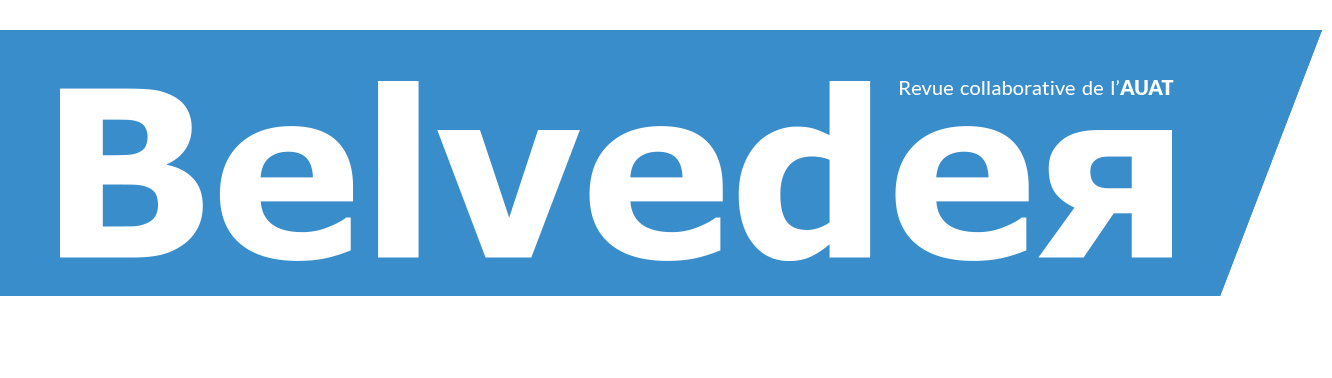Téléchargez l’article au format PDF
Loïc GEINDRE
Directeur d’études et gérant de la Coopérative Place
Céline LOUDIER-MALGOUYRES
Socio-urbaniste, L’usage des lieux
L’arrivée de nouveaux habitants est un enjeu décisif pour l’avenir des vallées pyrénéennes. Une étude commandée par le SGAR Occitanie en 2020 a fait le point sur ces évolutions à travers des données chiffrées et cartographiées à l’échelle des deux massifs de la région, les Pyrénées et le Massif central. L’enjeu : comprendre les réalités de ces massifs en termes de démographie, d’emploi et de logement. Au-delà, il s’agit de pouvoir éclairer le plus finement possible les enjeux d’un accueil durable des nouveaux habitants, c’est-à-dire un accueil qui vient soutenir la vitalité de ces territoires et le maintien des services aux publics pour le bénéfice de tous, notamment de la population déjà installée.
Adossé à cette expertise quantitative, un autre volet s’est attaché à révéler les ressorts sociologiques de ces mouvements démographiques, vers les montagnes pyrénéennes notamment. Cette approche sensible – illustrée de portraits photographiques – a permis de proposer une typologie pour identifier qui sont les nouveaux habitants de ces zones de montagne. Qu’est-ce qui les a fait venir là, en montagne ? Que viennent-ils y chercher ? Quelle contribution ont-ils apportée à leur territoire d’accueil ? Tour d’horizon de ces nouvelles et nouveaux venus, qui resteront… ou pas, en sept profils.
Alors que la région Occitanie connaît une croissance démographique toujours à haute intensité, la vitalité démographique des Pyrénées se fragilise… avec une population qui stagne, plus qu’elle ne gagne. Depuis les années 2000, un fléchissement de la dynamique démographique s’observe autour de deux phénomènes : l’accélération du vieillissement de la population locale, et un jeu des entrées et des sorties de plus en plus marqué par les départs, qui témoignent des difficultés des territoires à maintenir leur population, ainsi que de leur perte d’attractivité. Mais le massif pyrénéen n’est pas monolithique. Il recouvre des modèles de développement pluriels, avec des attracteurs qui renvoient à leur histoire, leur géographie, leur culture de l’accueil… largement contrastés. In fine, entre les Pyrénées Orientales très touristiques, l’Ariège plus enclavée, ou les Hautes-Pyrénées à l’économie locale diversifiée, les mouvements oscillent entre croissance, déclin, repli, voire accélération du cycle de fragilité démographique. Si la montagne vit toujours son exode rural, elle accueille aussi un exode urbain. Des échanges de population sont en cours, qu’il faut renseigner pour comprendre si un nouvel équilibre démographique est en train de se réaliser, dans la réalité ou simplement à travers les récits de quelques-uns.
Les télétravailleurs qui ont sauté le pas
Ils arrivent de la grande ville, avec leur bagage culturel et social, leurs capacités financières assurées. Ils choisissent la montagne par attrait pour les grands paysages, les sports d’altitude, la qualité environnementale (manger local et bio, s’éloigner de la pollution). Mais ces télétravailleurs ne recherchent ni la rupture avec leur vie d’avant, ni l’isolement dans les montagnes. Ce nouvel ancrage est davantage une nouvelle étape dans leur parcours de vie. Ils conservent des liens forts avec leur ancienne vie urbaine et restent mobiles. De fait, ils s’installent plutôt dans les bourgs structurants pour rester connectés (aux transports, aux services…) et sont attentifs à l’offre scolaire ou la vie socioculturelle qui vient conforter et confirmer leur choix de rester ou non.
Les entrepreneurs catalyseurs
Un territoire du possible, une terre d’opportunités, où pouvoir trouver une place : voilà comment la montagne leur apparaît. Leurs parcours racontent qu’ils cherchent du sens, et que c’est celui-ci qui guide leur projet d’installation. Pensé en amont pour certains, avec une simple mais grande motivation pour d’autres, ils sont à l’affût des opportunités qui vont s’offrir à eux : un local à transformer, un commerce qui se ferme, une grange à rénover, une activité à reprendre… Ils créent alors cette nouvelle vie autour d’une activité choisie et d’une création d’entreprise comme alternative à un bassin d’emploi atone. C’est le temps qui va alors jouer sur la confirmation de leur installation, car l’entreprenariat suppose un temps de maturation, de découverte et de (re)connaissance réciproque avec l’écosystème local. Là, la capacité à accueillir avec bienveillance ces porteurs de projets conditionne leur pérennisation. La contribution au territoire est forte pour ces actifs qui alimentent un effet de système et activent des chaînes de production (par exemple pour l’artisanat : autour des fournisseurs, producteurs, distributeurs, clients…). Avec des valeurs de vie réfléchies, partagées avec d’autres habitants, ils entrent et entretiennent des réseaux forts avec le milieu local, comme avec leur milieu choisi.
Les travailleurs « appelés » par l’économie locale
Saisonniers, employés d’une collectivité, salariés d’une entreprise locale, ils s’installent avec un projet de vie de plus ou moins long terme à partir de cette opportunité professionnelle qui les a fait venir. Une fois embauchés, la question de leur accueil se pose dans ses différents aspects : logement, emploi du conjoint, scolarisation des enfants, découverte des offres de loisirs et culturelles… Le rôle des employeurs est ici essentiel, mais la réponse du territoire l’est tout autant pour activer une politique d’attractivité, dont l’enjeu est de faire venir, mais aussi de faire rester. Ce profil constitue une ressource qui se raréfie en montagne, palliant les besoins de main d’oeuvre des secteurs où les offres d’emploi ne sont plus pourvues par la population locale qui s’amenuise au gré de son vieillissement, notamment.
Les cultivateurs des terres de montagne
Renouer avec la terre, en quête d’une bonne terre où prendre racine, ces « néos » défrichent, reprennent, renouvellent, diversifient… mais à condition d’avoir trouvé les clés de l’accès au foncier. Pour la plupart « non issus du milieu agricole » (NIMA), leur arrivée n’est pas toujours perçue d’une très bon oeil par les agriculteurs locaux qui ont élevé leurs enfants dans la fatalité de l’exode rural. La réconciliation se produit cependant quand les nouveaux prouvent leur valeur travail aux anciens, leur capacité à participer à l’entretien des paysages (entretien des fossés et des haies, par exemple), leur ténacité face à l’adversité. Une fois que « l’on a fait ses preuves », l’accueil est moins rude, « les anciens voient le travail, c’est la conscience du paysan ». La reconnaissance des locaux donne alors les clés des terres, des maisons, et plus encore, des estives. Devenir ayant droit des estives, pour un néo, c’est le sommet de l’ancrage territorial.
Les retraités qui se mettent au vert
À ce moment charnière de la vie, la montagne devient le lieu choisi, le « domicile de coeur » d’un projet de vie que l’on peut enfin se permettre de réaliser. Le plus souvent, ces nouveaux connaissent en fait bien le lieu où ils s’installent, puisqu’ils le fréquentent depuis des années. L’idée d’y venir ne date pas d’hier, elle a mûri longtemps dans leur esprit. Ils savent donc ce qu’ils viennent chercher. L’impact des nouveaux retraités se traduit sur l’économie résidentielle, et c’est tout un système qui s’organise autour de la « silver économie » : santé, commerces ciblés, offre de loisirs, services à la personne. Mais en vieillissant, ces retraités, d’abord mobiles et actifs, se préoccupent de proximité, et l’offre locale doit tenir le cap pour ne pas remettre en cause leurs parcours de vie en montagne.
Les exilés volontaires… ou pas
Échapper à la violence des espaces urbains quand on n’a plus accès aux marchés du logement ou de l’emploi, chercher refuge quand sa situation de vie s’est dégradée, sont des motifs d’arrivée pour des parcours d’itinérance, parfois d’errance, ponctués par des rendez-vous économiques avec la saisonnalité agricole ou celle, culturelle, des festivals. Ils sont pris et portés par les réseaux du bouche à oreille, des communautés, des associations, ou des mauvais effets d’aubaine qu’offrent la location de logements insalubres, mais aussi des filières de l’action sociale quand ils sortent de l’invisibilité. Plus que des aménités du paysage ou du grand air, ce sont des réponses à des besoins parfois vitaux qu’ils viennent donc chercher : un toit, un réseau d’entraide, d’accompagnement, un coût de vie beaucoup moins élevé, un environnement bienveillant. C’est en fait une mise à l’abri avec, en creux, une envie de s’en sortir, de rebondir, de souffler pour mieux repartir. Pour certains, ce peut aussi être le dernier recours d’un parcours en impasse, dans lequel l’isolement géographique validera une marginalisation, voire l’exclusion. Face à cette fragilité, à ces vulnérabilités multiples, les besoins d’accompagnement sont énormes : logement, santé, formation, emploi, entraide, famille… Leur accueil se fait souvent avec force d’innovation et de mobilisation de tissus solidaires entre travailleurs sociaux, bénévoles et associatifs, qui finalement travaillent à faire vivre cette idée de la montagne, lieu d’accueil et de refuge.
Les travailleurs de la gratuité
« La recherche des uns et des autres, la sobriété heureuse, quitter le monde de la consommation, changer de rythme ». C’est le désir de se mettre à l’écart d’une société avec laquelle on n’est plus en phase. La montagne est placée sous le signe de la frugalité, de la solidarité, et la démarche d’installation se fait avec le désir de rejoindre des réseaux et de s’inscrire dans le territoire. L’entrée par les lieux associatifs, culturels et solidaires constitue un tremplin à leur installation. Hors des schémas traditionnels du travail, ils vivent sur des petites retraites, les minimas sociaux, les petits boulots, les allocations et tout un réseau d’entraide et de partage. Ils prennent part à la vie locale dans une position souvent militante d’un engagement citoyen. Cette foi alternative dans des modes de vie en-dehors des normes traditionnelles peut générer des conflits avec les anciens comme avec les collectivités en place, qui portent un regard plus ou moins bienveillant sur ces idéalistes qui, dans un même mouvement, apportent du dynamisme au territoire et bousculent ses règles de vie ancestrales.
Les politiques d’accueil à l’épreuve
Que nous racontent ces profils ? D’abord, que celles et ceux qui ont le projet de s’installer dans les montagnes, avec des motivations et des ressources différentes, ont des besoins aussi variés que le logement, l’accompagnement à l’activité professionnelle, la santé, la famille, l’offre de services et de vie socioculturelle… Autant dire un registre large d’accompagnement à la bonne distance, qui demande une certaine force à l’action publique locale pour faire face à des nouvelles attentes, parfois exigences. Ce que l’on comprend aussi, c’est que ces sept profils sont traversés par la même envie de venir chercher un rapport au monde différent de leur expérience précédente, souvent urbaine, sinon métropolitaine : un rapport au travail plus libéré, une économie de vie sur le principe d’un développement maîtrisé, choisi, parfois une sobriété heureuse… Mais si, souvent, ces néos sont attendus avec impatience, parfois à coup de marketing territorial et de propositions d’installation, tout cela peut aussi entraîner des relations qui ne sont pas toujours fluides avec les institutions publiques, et plus largement avec la société qui les accueille. Quand les collectivités et leurs partenaires ne comprennent pas les porteurs de projet (qu’est-ce qu’un projet économiquement viable quand on innove ? comment aider la mise en réseau autrement que par de l’investissement ?), quand les nouveaux créent des dynamiques culturelles en réseau qui pèsent finalement plus lourd que les traditionnelles associations locales et se sentent légitimes dans la revendication de lieux… apparaissent alors des situations d’incompréhensions, de tensions, de conflits, qui doivent être résolues pour que l’accueil soit durable. Les nouveaux voient un eldorado là où certains vivent le déclin. Les nouveaux ont le sentiment d’une terre des possibles, animés par l’idée de création, alors que les anciens sont parfois encore dans cette idée qu’il faut en partir pour s’en sortir. Ici se situe sans doute un enjeu central pour ces territoires de montagne en mutation démographique et sociologique : trouver les leviers, les (tiers) lieux, les réseaux pour donner envie aux nouveaux comme aux natifs de s’inscrire dans une histoire locale commune. Que chacun, avec son mode de vie, puisse trouver sa place, à côté de ceux qui y sont déjà.
©Christophe Goussard
Contenu additionnel :
Lien vers l’étude sur les nouveaux arrivants et l’offre et la demande de logements dans les massifs d’Occitanie sur le site de la Préfecture Occitanie : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/Les-nouveaux-arrivants-et-l-offre-et-la-demande-de-logements-dans-les-massifs-d-Occitanie