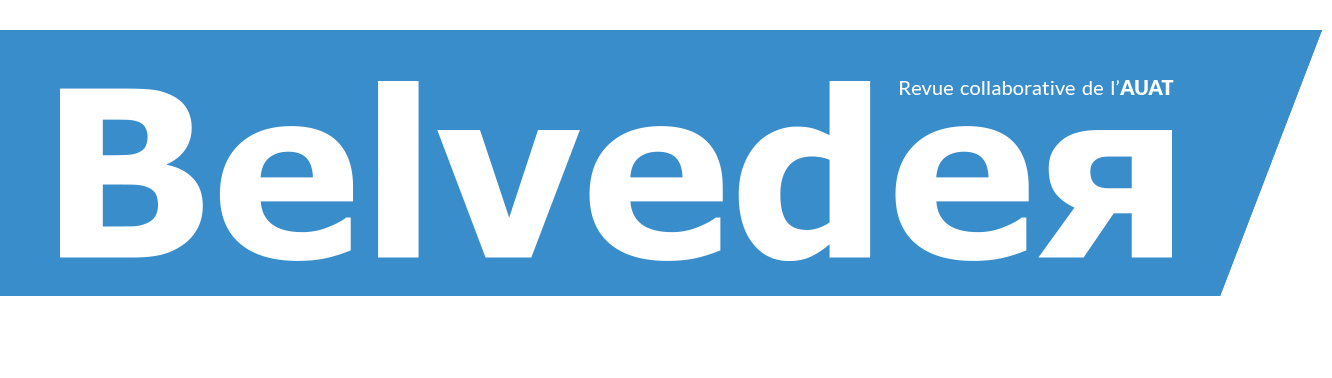Téléchargez l’article au format PDF
Marie MOLINIER
Démographe, chargée de projets Cohésion sociale et attractivités, AUAT
Depuis quelques mois, j’ai une idée qui m’obsède. J’essaie de la faire taire, mais elle revient sans cesse et pourtant, elle est si difficile à avouer à mon entourage. J’ai peur qu’ils ne comprennent pas. Moi qui ai toujours été un pur produit des grandes villes, au point d’en devenir une caricature. Je ne me pose jamais la question de savoir si j’ai de quoi faire à manger parce que je sais qu’il y a une supérette ouverte, et sinon, je pourrai toujours me faire livrer. Je ne me déplace plus qu’en vélo parce que tout m’est accessible facilement. Le week-end, vous me trouverez dans une expo ou à un concert avec cette bande d’amis qui vit dans le même quartier que moi. Bref, je suis une adepte des métropoles. Et pourtant… j’ai envie d’une ville moyenne !
Note de la rédaction : cet article est une fiction. Il ne prétend pas à l’exhaustivité et n’épuise pas la diversité des regards que l’on peut porter sur ces territoires.
J’aurais du mal à expliquer d’où ça m’est venu, cette envie s’est installée progressivement sans même que je m’en rende compte. Ce qui me rassure, c’est que je ne suis pas la seule à y avoir pensé. Les premiers dont je me rappelle, c’étaient mes voisins de palier qui avaient fini par devenir des amis. Un jour, ils m’ont annoncé qu’ils vendaient l’appartement et qu’ils allaient s’installer à Auterive, où ils venaient d’acheter une maison avec jardin dans la perspective d’y agrandir la famille. Sur le moment, je n’ai pas compris, je leur ai dit qu’ils devaient être fous de vouloir autant s’éloigner de la ville et qu’ils allaient passer leur temps dans la voiture. En fait, je craignais surtout qu’on ne se voit plus, parce que moi, Auterive, je n’y ai jamais mis les pieds. Puis il y a eu le Covid-19, on s’est tous retrouvés confinés, et même si, globalement, on l’a bien vécu, l’envie d’espace et de grand air s’est installée. Au même moment, on a tous franchi le cap de la trentaine, et les projets de famille, eux aussi, se sont installés. L’accès à un logement plus grand s’est vite imposé comme un préalable à toute naissance. Si une partie de mes amis auraient bien aimé rester à Toulouse, l’offre plus limitée en grands logements et son coût a contraint certains à s’éloigner. Le déploiement du télétravail leur a permis d’envisager plus sereinement cet éloignement de la Métropole avec laquelle ils continueraient d’entretenir des liens presque quotidiens. Il a même conduit certains à s’éloigner plus que prévu, accédant à des territoires jusqu’alors moins prisés par les Toulousains. D’ailleurs, ce n’est pas qu’un ressenti, les chiffres le confirment : dans les années suivant la pandémie, les écoles primaires des communes situées entre 10 et 50 km de Toulouse ont connu de plus nombreuses arrivées d’élèves originaires d’autres territoires et les transactions immobilières ont fortement augmenté, avec des acheteurs notamment en provenance de la Métropole. Finalement, la pandémie de Covid- 19 n’a pas fondamentalement révolutionné les trajectoires résidentielles, mais elle a accéléré la mise en œuvre de projets déjà existants.
La première personne à qui j’ai osé parler de cette envie naissante, c’est ma colocataire. Et c’est tout naturellement qu’elle m’a répondu : « Tu aimes les villes moyennes, en fait ». Il faut dire qu’elle s’y connaît, elle est prof d’histoire-géo. Et me voilà dans sa classe ! Elle m’explique que s’il n’existe pas de définition unique des villes moyennes, cette dénomination a pour but de les différencier des grandes métropoles et des territoires ruraux. Plusieurs seuils statistiques de population sont régulièrement évoqués, mais dans une étude récente sur les trajectoires des villes moyennes en Occitanie[1], l’Insee propose une définition. Une ville moyenne compte entre 10 000 et 100 000 habitants et n’appartient pas à l’unité urbaine d’une autre commune plus peuplée. Par exemple, Blagnac et ses 27 300 habitants n’est pas considérée comme une ville moyenne car elle appartient à la banlieue de Toulouse. Ces villes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre territorial car elles exercent bien souvent une fonction de centralité intermédiaire en concentrant différents services publics, un bassin d’emploi et de formation, et un réseau de transports développé. Toutefois, ces villes traduisent aussi des réalités contrastées. Longtemps évoquées comme les grandes oubliées de l’aménagement du territoire, elles font face à plusieurs difficultés mises en avant par la Cour des comptes dans un rapport consacré aux villes moyennes d’Occitanie[2]. Leur développement peut s’avérer freiné par une dépendance économique à un nombre limité de secteurs qui contraint une partie des habitants à aller chercher du travail ailleurs. Leur centre-ville perd parfois en vitalité au profit des communes de périphérie où s’installent une partie des ménages participant au phénomène de périurbanisation. Elles doivent également composer avec un difficile équilibre budgétaire marqué par un endettement supérieur à la moyenne nationale des communes. Mais malgré ces fragilités, les dernières années semblent annoncer un regain d’intérêt de la population pour ces territoires. Les 44 villes moyennes d’Occitanie ont vu leur rythme de croissance multiplié par deux depuis 2016, mettant fin à plusieurs décennies d’un rythme constant (+0,6 % par an entre 2016 et 2022, contre +0,3 % depuis 1982).
Après cette leçon de géographie, je retrouve une amie pour un café et je lui raconte ce que je viens d’apprendre. Cela fait tout de suite écho à l’histoire de son frère qui est en train de quitter la banlieue marseillaise pour venir s’installer à Tarbes avec sa compagne. Amoureux de la nature, cela fait quelques temps qu’ils cherchent une maison à acheter avec un grand jardin pour leurs deux chiens, et un accès rapide au « grand air ». Malheureusement, le marché immobilier de la région les a contraints à reconsidérer leur projet, faute de biens à leurs goûts et dans leurs prix. Disposés à changer de secteur, ils ont rapidement envisagé le Sud-Ouest, avec lequel ils ont quelques attaches familiales et qui répond pleinement à leurs envies de montagne. Elle est en recherche d’emploi, ce qui facilite sa mobilité, et lui est ingénieur industriel. Si leur choix s’est porté sur Tarbes, c’est parce qu’il a facilement trouvé du travail grâce au développement économique à l’œuvre. Historiquement, le territoire tarbais fut l’un des bastions de l’industrie de l’armement au travers de l’Arsenal de Tarbes, implanté depuis 1796 et qui a fortement contribué à son développement. Cependant, à partir des années 1980, le processus de désindustrialisation a particulièrement impacté la ville, jusqu’à la fermeture de l’Arsenal en 2006. Si, durant cette période, Tarbes a pu compter sur les secteurs tertiaire et universitaire, cela n’a pas permis de compenser la baisse de son attractivité, qui s’est traduite par une diminution continue de sa population. Ce n’est qu’à partir des années 2010 que le territoire a entamé sa mutation économique en diversifiant ses activités industrielles. C’est dans ce contexte que s’inscrit la labellisation, en 2019, du territoire Lacq-Pau-Tarbes dans le cadre du programme national Territoires d’industrie, destiné à soutenir l’industrie française dans les territoires. Pour Tarbes, cette reconnaissance a marqué un tournant et deux secteurs en ont particulièrement bénéficié : l’aéronautique, avec la présence de Daher ou encore Tarmac Aerosave (spécialisée dans le stockage et le recyclage d’avions) ; et le ferroviaire, porté par Alstom, qui a fait de Tarbes l’un de ses pôles d’excellence pour la traction électrique. Concrètement, cela s’est traduit par la création de près de 3 000 emplois entre 2016 et 2023 à l’échelle du bassin de vie tarbais[3]. Sans nul doute, ce dynamisme économique est une des raisons de retour à la hausse de la population depuis 2016, auquel viendront bientôt s’ajouter deux anciens Marseillais.
Évidemment, je me doutais bien que le développement économique était un levier essentiel à l’attractivité des villes moyennes, mais il en est un autre auquel je n’avais pas pensé. C’est une discussion avec mon cousin, en pleine réflexion sur son cursus post-bac, qui me l’a révélé. Il souhaite aller à l’université, mais n’est pas enthousiaste à l’idée de rejoindre les campus des grandes villes. Il leur préfère des universités plus petites, dans des villes qu’il décrit « à taille humaine » et où il pense que le coût de la vie sera plus compatible avec le montant de sa bourse. Et il n’est pas le seul à s’orienter vers les villes moyennes : elles accueillent 20 % des étudiants d’Occitanie et la progression de leurs effectifs a été plus importante que dans les métropoles au cours de la dernière décennie. Pour les identifier, la Région a mis en place le label « ville universitaire d’équilibre » qui désigne les villes moyennes accueillant un établissement d’enseignement supérieur structurant et dispensant une offre de formation allant au moins jusqu’à la licence. À l’échelle de la région, 18 villes moyennes sont labellisées, dont Montauban, Rodez, Tarbes et Albi. C’est d’ailleurs vers cette dernière que mon cousin s’oriente. Avec son offre d’enseignement répartie principalement autour de deux établissements à fort rayonnement (INU Champollion et IMT Mines Albi), elle compte 6 000 étudiants, soit 12 % de sa population. Depuis 2016, la ville connaît un regain de croissance, en grande partie expliqué par son attractivité auprès des jeunes adultes. Les 15-29 ans représentent plus de la moitié des nouveaux arrivants chaque année, mais également une part importante des départs. Le solde migratoire est excédentaire uniquement pour les étudiants de premier cycle. Au-delà, les départs de jeunes sont plus nombreux que les arrivées. Cette dynamique n’est pas spécifique à Albi et concerne de nombreuses villes universitaires. Elle peut s’expliquer à la fois par une moindre offre en master et doctorat, qui contraint les étudiants à se rapprocher des métropoles pour poursuivre leur cursus, mais également par un bassin d’emploi qui ne correspond pas aux recherches de ces jeunes diplômés. Si l’offre d’enseignement supérieur est un atout pour les villes moyennes, l’enjeu est aussi de permettre à une partie des étudiants de se maintenir sur le territoire, d’autant plus dans un contexte de baisse de la natalité qui se répercutera bientôt sur les effectifs étudiants.
Dans les semaines qui ont suivi ces échanges, j’ai décidé d’aller voir de mes propres yeux ce que ces villes moyennes avaient à offrir. J’ai presque honte de l’avouer, mais j’avais sous-estimé la richesse de leur patrimoine culturel et historique. Je craignais de le perdre en quittant Toulouse, mais c’était sans compter sur la cité médiévale de Carcassonne et la cité épiscopale d’Albi, toutes deux classées au patrimoine mondial de l’Unesco, sur le musée Champollion de Figeac, sur les vignobles gaillacois, les bords du canal du Midi et bien d’autres. J’ai été particulièrement séduite par le centre-ville de Cahors. Elle fait partie des 28 villes soutenues par le programme national Action cœur de ville. Lancé en 2018, ce dispositif vise à revitaliser le centre des villes moyennes en soutenant financièrement des projets autour du logement, du commerce, de la mobilité ou du cadre de vie. Il a déjà permis la réhabilitation de 500 logements, le réaménagement de la Halle et le soutien aux commerces de proximité, ainsi que d’autres opérations de renouvellement urbain du centre ancien. Bien sûr, ce dispositif ne règle pas tous les problèmes. Dans sa thèse sur la revitalisation des centres des villes moyennes[4], Mikaël Dupuy Le Bourdellès pointe les difficultés rencontrées par l’action publique pour attirer les familles dans les centres-villes. Parce qu’ils se caractérisent bien souvent par un parc résidentiel spécialisé dans les petits logements locatifs, ils constituent des quartiers d’accueil privilégiés par les petits ménages. La diversification du parc est un des leviers, mais se heurte au faible nombre d’opérateurs immobiliers enclins à s’y installer. Toutefois, il est certain que ces améliorations ont participé aux dynamiques démographiques récentes de la ville, qui renoue avec la croissance.
J’ai aussi bien conscience que ma situation est privilégiée, car mes conditions de revenus et ma situation professionnelle et personnelle me permettent d’envisager des mobilités plus librement que d’autres, parfois captifs de leur lieu de vie. Les trajectoires résidentielles ne sont pas que des choix personnels et dépendent aussi de ce que les territoires ont à offrir pour répondre aux impératifs du quotidien. L’emploi et le logement demeurent les principaux leviers de développement des villes moyennes, mais sont loin d’être les seuls. L’éducation, la mobilité, le cadre de vie, le niveau d’équipements en sont autant d’autres qui peuvent favoriser leur attractivité. Peut-être que mon prochain chapitre s’écrira dans une ville moyenne, finalement peu importe, tant que je m’y sens bien !
[1] Insee, « Les villes moyennes en Occitanie : cinq trajectoires depuis 1999 », Insee Flash Occitanie n°134, août 2024.
[2] Cour des comptes, « Les villes moyennes en Occitanie », rapport régional, octobre 2020.
[3] Évolution de l’emploi salarié privé dans l’aire d’attraction de Tarbes ». Source ACOSS.
[4] Mikaël Dupuy Le Bourdellès, « Revitaliser » les centres des villes moyennes : action publique et (im)mobilités résidentielles, thèse de doctorat en urbanisme, Université Gustave Eiffel, 2024.