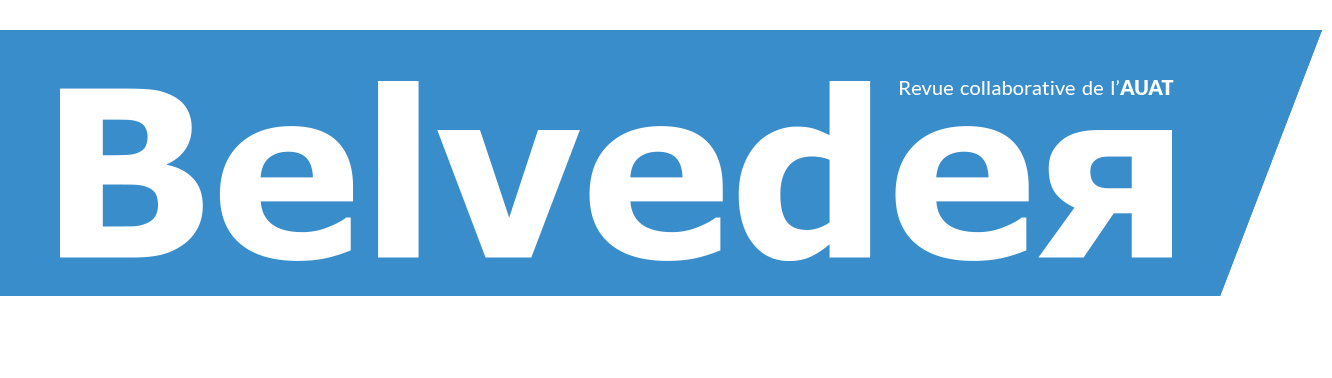Téléchargez l’article au format PDF
Lionel DELBOS
Conseiller économie territoriale et enseignement supérieur, France Urbaine
Quels sont les impacts du ralentissement de la croissance démographique française sur la population étudiante ? Combien y aura-t-il d’étudiants en 2030 ? En 2050 ? Où choisiront-ils d’étudier ? La baisse de la population étudiante qui se dessine interroge l’attractivité des territoires accueillant une offre d’enseignement supérieur, soulevant ainsi des questions d’équilibres territoriaux. Lionel Delbos, conseiller en économie, enseignement supérieur et culture à France urbaine, nous donne des clés de compréhension des impacts territoriaux de la démographie étudiante.
Quelles grandes tendances se dessinent en matière d’évolution des effectifs étudiants ?
Le sujet d’une baisse à venir de la population étudiante au niveau national est majeur. Tout le monde est au courant, mais on en parle encore assez peu. Nous pouvons pourtant la pressentir de façon intuitive au regard des fermetures de classes qui apparaissent un peu partout dans les collèges et lycées. Cette baisse va bien se traduire à l’échelon universitaire à un moment ! Les projections établies par le SIES[1] donnent différentes indications. Nous sommes aujourd’hui sur un palier autour de 3 millions d’étudiants. Le SIES prévoit encore une légère croissance des effectifs jusqu’en 2032, puis une baisse. En extrapolant les hypothèses les plus pessimistes en matière de démographie étudiante, la baisse pourrait être de l’ordre de 800 000 étudiants en moins à l’horizon 2050. Au-delà de la dimension démographique, d’autres aspects sont à prendre en compte dans cette équation : rayonnement des universités, impacts de Parcoursup, attractivité pour les étudiants internationaux, rôle des classements… Face à cela, nous percevons deux risques. D’une part, celui d’une exacerbation des logiques concurrentielles entre territoires afin d’attirer des étudiants qui seront moins nombreux, car cette population est « stratégique » du point de vue de l’attractivité. D’autre part, celui d’une re-concentration au profit des métropoles, naturellement attractives. La mise en place d’une stratégie d’aménagement universitaire permettant de repenser l’alliance entre collectivités et établissements nous paraît ainsi indispensable. Derrière le sujet de la démographie étudiante, il y a de vraies questions en matière de politiques publiques dédiées à l’enseignement supérieur et de conditions d’accès des jeunes à l’enseignement supérieur. Nous souhaitons provoquer une prise de conscience sur ces sujets à France urbaine, car cela fait des décennies que les politiques sont élaborées en envisageant uniquement une croissance continue des effectifs étudiants et une attractivité accrue des grandes intercommunalités urbaines pour les étudiants.
Comment les intercommunalités se saisissent-elles justement de ces enjeux ?
Les postures et les stratégies sont très diverses. Il faut bien entendu prendre en considération que les marges d’action des intercommunalités restent limitées par leurs compétences, et que les étudiants vont étudier là où ils souhaitent ou peuvent. Les stratégies et schémas élaborés sur ce sujet demeurent ainsi incitatifs. Si certaines intercommunalités affichent clairement l’objectif d’accueillir plus d’étudiants (Saint-Étienne, Le Mans ou Nice, par exemple), d’autres se positionnent au contraire vers une modération, voire une réduction des effectifs afin d’améliorer la qualité de leur accueil, de leur insertion et de l’offre de services (Angers ou Valenciennes, notamment). Dans cette analyse, il est primordial de prendre en compte les enjeux économiques de l’enseignement supérieur, d’autant plus dans le contexte international et national actuel. Pour rappel, l’essentiel des créations d’emplois depuis 25 ans l’ont été dans le secteur tertiaire, et donc largement captées par les métropoles. Aujourd’hui, l’emploi industriel et productif revient sur le devant de la scène, avec une mise en avant d’autres territoires. Les aires de Cherbourg, Le Creusot ou Dunkerque, par exemple, affichent plusieurs milliers d’emplois à pourvoir autour des domaines de l’énergie, du nucléaire, de la défense… Jusqu’à maintenant, ce sont pourtant des territoires qui perdaient des habitants et qui n’avaient qu’une offre d’enseignement supérieur modeste ou « locale ». Il y a donc toute une réflexion à mener sur la répartition spatiale de l’offre de formation et son articulation avec l’emploi, sans pour autant être « adéquationniste » et vouloir aligner strictement une offre d’enseignement sur les besoins des entreprises locales. Les collectivités et les élus doivent alors prendre conscience des enjeux et de leur rôle sur le sujet. De ce point de vue, nous notons des écarts considérables d’appropriation selon les territoires. Dans les grandes métropoles, la crainte d’une baisse de la population étudiante et l’idée d’une reconfiguration des lieux de formation reste mesurée, du fait de l’offre de formation existante, de la qualité de la vie étudiante, de la présence d’autres aménités… Si la perspective d’une baisse des effectifs étudiants est évoquée, l’idée dominante est que ce sont plutôt les métropoles intermédiaires ou les villes moyennes qui pourraient en pâtir. Face à ces questions, ne faudrait-il pas responsabiliser les territoires les plus attractifs, notamment au niveau du couple EPCI-Région, pour travailler et repenser l’offre de formation à l’aune des évolutions démographiques à venir ?
Avez-vous des exemples de territoires qui se sont pleinement emparés de ce sujet ?
À Dunkerque, par exemple, la communauté urbaine s’est saisie de la question et se positionne comme tiers de confiance et cheffe d’orchestre de l’offre de formation sur son territoire. À Valenciennes, la politique menée en matière d’enseignement supérieur, en lien avec les acteurs économiques (implantation de Toyota, notamment) a conduit à l’ouverture d’un nouveau campus, celui de l’université polytechnique Hauts-de- France (UPHF). Les effectifs sont passés de 7 000 à 14 000 étudiants en quelques années. On voit donc que certaines intercommunalités s’emparent avec force de cette question, même si elle ne relève pas de leurs compétences au sens strict et obligatoire. En effet, du fait de leurs autres domaines d’action, notamment sur le plan du développement économique, elles considèrent que l’offre de formation présente sur leur territoire relève de leur responsabilité. En témoignent les nombreux EPCI ayant une vice-présidence à l’enseignement supérieur. À France urbaine, nous souhaitons donc inciter les territoires à s’approprier cette question, sans attiser néanmoins la concurrence entre eux. Les Régions doivent demeurer cheffes de file et assurer la bonne coordination de l’offre de formation avec, en parallèle, une interpellation des métropoles pour qu’elles coopèrent avec leurs territoires voisins. Nous relevons aussi des questions soulevées par le contexte budgétaire actuel. C’est notamment le cas des campus connectés, présents sur certaines villes moins peuplées et distantes des pôles universitaires, qui accueillent chacun quelques dizaines d’étudiants. Leur efficience, au regard de leur coût, a été remise en question dans un récent rapport de la Cour des comptes, ce qui renforce l’idée d’un risque de reconcentration ou d’affaiblissement de l’implantation territoriale de l’offre universitaire. Il y a également un autre paramètre à intégrer : celui de l’enseignement supérieur privé lucratif et de son expansion rapide en France, en particulier depuis la réforme de l’apprentissage en 2018. Aujourd’hui, ces structures accueillent près d’un quart de l’ensemble des étudiants, mais échappent pour la plupart à tout contrôle et toute régulation. Certains établissements se positionnent hors-Parcoursup et jouent de ce positionnement pour attirer des jeunes et leur famille. On aura beau actionner de nouveaux leviers de coopération entre les territoires, avec les Régions, et renforcer le rôle de l’État dans l’enseignement supérieur, la majorité de ces acteurs sont hors circuit et s’implantent où ils le veulent. On constate d’ailleurs que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ils ne s’installent pas uniquement dans les grandes métropoles, mais aussi dans des agglomérations de taille intermédiaire.
En parallèle, quelles évolutions percevez-vous sous le prisme du logement et du cadre de vie ?
Il y a bien sûr beaucoup d’expressions sur le fait que le coût du logement devient un facteur de contrainte, voire de discrimination dans les choix d’orientation des jeunes. Sur ce volet-là, des territoires axent leur marketing territorial sur leur relative « accessibilité » du point de vue du coût du logement pour attirer de nouveaux étudiants, en comparaison de grandes villes devenues trop chères. Il y a de vraies ambiguïtés de la part des métropoles en matière d’investissements sur l’offre de logements étudiants. Certaines communes-centres refusent la construction de nouveaux logements étudiants sur leur territoire en argumentant que l’offre de formation est présente sur d’autres communes, que le public étudiant n’est pas présent toute l’année, qu’il peut générer des nuisances… En parallèle, de grands groupes immobiliers associés à des structures d’enseignement supérieur privées se positionnent sur ces territoires et démarchent les élus avec des solutions all inclusive, valorisantes financièrement. Dans un seul et même bâtiment, on peut ainsi trouver une école d’enseignement supérieur privée, des logements étudiants, d’autres logements, des bureaux, des services, de l’hôtellerie, de la restauration…
Quels autres éléments sont à prendre en compte dans la lecture de la diminution annoncée de la population étudiante ?
Il faut aussi se pencher sur l’âge des étudiants français, qui sont les plus jeunes parmi les pays de l’OCDE (l’âge d’entrée moyen dans les études est plutôt de 20 ans dans les autres pays). Une partie importante du taux d’échec dans certaines filières s’explique par cela, ce qui accentue les inégalités d’accès géographique. Quitter brutalement son foyer familial à 18 ans et être en autonomie, pour une partie des jeunes, c’est compliqué. Nous pouvons aussi aborder la question des étudiants internationaux. En France, ces derniers sont plutôt francophones et originaires du continent africain, et n’ont donc pas le même profil que les étudiants internationaux des pays européens voisins. Il est important de rappeler que le milieu de la recherche en France reste fortement tributaire de cet apport d’étudiants étrangers, en particulier dans les « sciences dures » (environ 2/3 de doctorants d’origine étrangère dans ce domaine). Certaines métropoles ont rejoint les Régions dans l’élaboration de véritables stratégies d’accueil, d’aide et de soutien financier auprès de ces étudiants étrangers. Enfin, une des réponses à l’affaissement démographique qui s’annonce serait aussi de repenser le tuilage entre lycée et enseignement supérieur, en améliorant notamment l’accueil des étudiants (accueillir moins, mais mieux), les modalités de recrutement, l’orientation… Il y a le bon exemple du dispositif des Cordées de la réussite qui envoie des enseignants et des étudiants à la rencontre de lycéens dans les zones rurales ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour leur dire qu’ils et elles ont toutes leurs chances d’entrer à l’école si le domaine les intéresse, ce qui peut aider à lever les obstacles culturels dans des territoires en décrochage marqués par de forts taux de chômage. Au-delà d’initiatives portées par quelques écoles, il n’y a pas encore de politique réellement organisée par les collectivités. Il s’agit d’un enjeu majeur pour des territoires hors métropoles que d’aller chercher des publics éloignés de l’enseignement supérieur. Il faut lever tout un ensemble d’obstacles culturels, sociétaux et démographiques.
Entretien réalisé par Florian Havard et Morgane Perset (AUAT).
[1] SIES : Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques, rattachée au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Voir la Note d’information du SIES n° 2025-07 du 19 mai 2025 : « Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2024 à 2033 ».