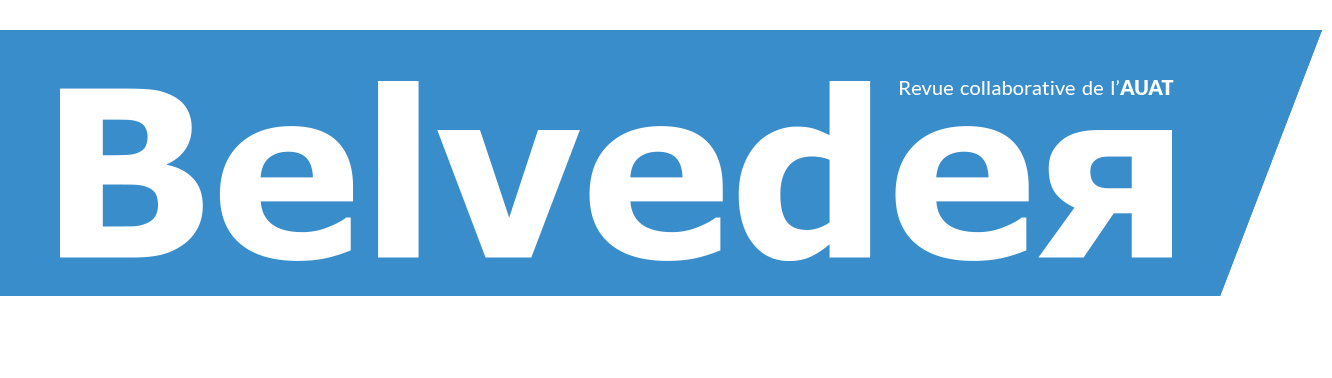Téléchargez l’article au format PDF
Lionel Rougé
Maître de conférences en aménagement et urbanisme
Université de Caen Normandie
« Hors de chez soi, il n’y a plus de lieu possible. Très rapidement, dehors, hors du pavillon – l’enclos de l’égo – le non-lieu (négation absolue), le lieu de transit devient une norme, car dans ces conditions, seul ce qui a trait à l’égo dans son enclos peut être qualifié positivement. Le reste, l’ailleurs, le dehors, l’espace entre, est condamné par la force des choses à être vidé de toute humanité au profit de la marchandise »[1].
L’accusation est catégorique. Les espaces pavillonnaires ne configureraient pas l’espace public, ils contribueraient même à le nier et ainsi à réduire son incarnation – la rue – à un simple axe de transit automobile. Morphologies anti-urbaines – particulièrement dès qu’il s’agit de lotissements, ces espaces ne participeraient pas à faire ville. Modèle d’une mise à l’écart désirée ou subie, les zones pavillonnaires ne seraient-elles pas pourtant, sur le temps long, davantage marquées par des situations de cohabitations pacifiées et des sociabilités constructives ? D’un instrument de la « bonne distance » à un levier de « bonne proximité », en quoi les usages de la rue pavillonnaire viennent dire quelque chose de la ville – de sa pratique et de ses représentations – de l’échelle du voisinage à celle de la métropole ?
Pour circonscrire le propos et tenter de l’illustrer, prenons comme archétype la rue d’un lotissement suburbain composé de ménages de la classe moyenne traversé par un renouvellement de son peuplement et par une transformation de son environnement urbain. Faisons l’hypothèse que ce type de configuration traverse nombre d’ensembles pavillonnaires de l’agglomération toulousaine et que cette trajectoire – bien que non linéaire – est susceptible de venir activer un glissement vers la rue d’une domesticité jusqu’alors inscrite dans le périmètre du logement et de la parcelle. Ce nouveau rapport entre la rue et les maisons qui la bordent viendrait souligner un moment de sédimentation incertaine propice à un accompagnement par les professionnels de la ville, de l’urbanisme et de l’architecture.
Fonctionnant d’abord, par le biais de l’automobile, dans sa relation circulatoire entre le domicile et les grands axes routiers, la rue pavillonnaire est un sas d’intensité de flux et de vitesse par rapport à son environnement urbain. Peu empruntée en dehors des horaires « de travail » sauf parfois à être, selon sa configuration, un circuit de détour quand les grandes artères sont bouchées, elle offre à ses résidents « calme et tranquillité » comme ils se plaisent à le dire. Si cette mise à l’écart des flux peut traduire une appropriation exclusive, l’instrument d’un « retrait résidentiel »[2], elle peut aussi s’analyser comme levier d’un dialogue entre sphères privée et publique, vécues non pas de manière continue mais plutôt de manière distincte. Bien souvent, la voirie est, soit doublée d’une contre-allée – dans les lotissements les plus récents, soit aménagée de telle sorte qu’une vitesse excessive n’y soit pas possible (trottoirs, stationnements décalés, bandes cyclables, zones 30…). Ces aménagements sont alors propices à des sociabilités apaisées et facilitent une cohabitation en continuité du jardin[3]. Pensée pour la circulation des voitures, la fonction de la rue mute, à force de temps et d’appropriations résidentes, vers un espace plus adapté à la circulation des corps. Cette oscillation, entre corridor de circulation et lieu de ralentissement, vient ainsi intercaler des temps plus propices aux mobilités actives (vélos, rollers, trottinettes…) et à la marche. En dialogue avec les jardins et l’appropriation des parcelles, ces usages, jusqu’alors repérables dans les tissus urbains à dominante pavillonnaire, s’observent aussi dans les lotissements périurbains et suburbains les plus anciens où se formalisent des logiques d’ancrages et où opère une maturation[4]. Voisinage, promenades avec ou sans chien, appropriation des contre-allées et des impasses par les enfants, discussions improvisées sur les trottoirs ou aux coins des rues par les habitants plus âgés, murs de séparation détournés pour devenir mobiliers propices à la rencontre et à la discussion … autant d’usages qui fabriquent du lieu et engendrent des sociabilités de moins en moins « discrètes ». La rue « voirie » se publicise ainsi doucement en s’ouvrant à l’altérité, par exemple par le percement d’un cheminement vers d’autres secteurs ou, plus rarement, par transformation de la trame viaire.
Rentrer dans une rue pavillonnaire, c’est faire l’expérience d’un contraste – moins de bruit, moins de hauteur, moins de vitesse. Ce « sas » qui protégerait – de la ville et de ses nuisances – on le ressent. En week-end, c’est un peu différent : avec le ballet des tondeuses à gazon, c’est aussi l’odeur, à la fois bucolique et artificielle – qui est saisissante. Car c’est bien par les jardins que semblent se fabriquer la valeur et la qualité de la rue pavillonnaire, sa valeur marchande et sa valeur d’usage. En ville, dans les quartiers péricentraux en proie à une densification, comme en banlieue, la somme des jardins pavillonnaires couplée aux démarches municipales (plantation d’arbres…) et à l’amorce de reconquêtes végétales plus ou moins sauvages des trottoirs, fonctionne comme autant d’oasis qui deviennent à la belle saison des lieux de promenades pour en apprécier arbres en fleurs, glycines, rosiers ou hortensias… La rue devient alors, le temps d’un week-end ou en début de soirée, espace de flânerie et de récréation où se rencontrent occupants des maisons savourant les aménités de leur jardin et passants qui profitent des senteurs et des couleurs, déambulent et se sentent invités à ralentir, voire à échanger avec les pavillonnaires sur cette esthétique de l’ordinaire – conseils de bricolage ou de décoration, dons de fleurs, de fruits ou de légumes.
Marcher dans une rue pavillonnaire, c’est aussi se prendre à observer les seuils des maisons. Ces deux à trois mètres, qui se donnent au public tout en appartenant au privé, révèlent une semi-intimité et sont une manière d’accéder à la connaissance intime de ces morceaux de ville et de leurs habitants. Ces rencontres, parfois seulement ponctuées d’un signe de la main, sont – au même titre que l’objet maison individuelle – un signe symbole de la force du modèle pavillonnaire. La rue devient, en écho aux travaux sur les parties communes des ensembles collectifs valorisés, un espace dans lequel s’opère un « jeu réglé d’évitements et d’ajustements, de respect et de reconnaissance qui autorise une quête furtive de familiarité »[5]. Ce jeu social fait d’implicite et de cordialité s’appuie sur des « accords préexistants plus ou moins formalisés » qui se déclinent selon les processus de construction et de sédimentation de ces ensembles pavillonnaires. Toute cette gamme d’accords tend à fabriquer des urbanités « douces » – « domestiques »[6] – qui traduisent aussi un ordre, une éthique, bien distincte des quartiers et secteurs voisins, surtout si ces derniers sont composés majoritairement d’immeubles. Une telle distinction est aussi pouvoir, parce que derrière cet ordre s’opère un contrôle social propre à l’univers pavillonnaire.
Observer et approcher les usages de la rue dans les zones pavillonnaires, c’est venir souligner qu’« hors de chez soi » un lieu est possible, qu’à côté du transit automobile la rue permet aussi des scènes de contacts plus ou moins informels. Alors, certes, ces usages peuvent, comme ailleurs, être les signes d’appropriations exclusives, voire d’une volonté de privatisation, mais ils dévoilent également des potentialités créatrices d’un commun. Il y a là, peut-être, matière à interroger dans le détail la diversité des configurations pavillonnaires : certaines sont-elles plus propices que d’autres à ces glissements ? À la faveur d’une sédimentation et de l’ancrage des résidents, la rue pavillonnaire devient support d’une transition relationnelle entre l’habiter domestique et l’habiter métropolitain ; un « sas » de ralentissement et d’interconnaissance. Consolider la désirabilité métropolitaine ne passerait-il pas, entre autres, par la réconciliation avec cet urbanisme de maisons, dès lors qu’il offrirait la possibilité de quartiers jardins dotés de services et d’espaces collectifs, supports d’une démocratie de proximité et où viendraient s’hybrider initiatives habitantes autant que démarches publiques ?
[1] DEBRY Jean-Luc, Le Cauchemar pavillonnaire, Éditions L’échappée, 2012.
[2] LOUDIER MALGOUYRES Céline, « Le retrait résidentiel », Esprit, n° 393, 2013, p. 45-60.
[3] JAILLET Marie-Christine, ROUGÉ Lionel, THOUZELLIER Christiane, « Vivre en maison individuelle en lotissement », in TAPIE Guy (dir.), Maison individuelle, architecture, urbanité, Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours », 2005, p. 11-23.
[4] BERGER Martine, ARAGAU Claire, ROUGÉ Lionel, « Vers une maturité des territoires périurbains ? », EchoGéo, 27/2014, mis en ligne le 02 avril 2014, consulté le 02 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/13683 ; DOI : https://doi.org/10.4000/echogeo.13683.
[5] PARIS Hervé, « L’inconnu familier, les interactions dans les parties communes d’un immeuble lyonnais », in HAUMONT Bernard et MOREL Alain (dir.), La Société des voisins, MSH, 2005, p. 132-147.
[6] BONY Laurent, DONNADIEU Brigitte, HARARI Jean, « Urbanités domestiques face au territoire », in TAPIE Guy (dir.), Maison individuelle, architecture, urbanité, Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours », 2005, p. 150-164.
Contenu additionnel :
Version longue de l’article : https://revue-belveder.org/wp-content/uploads/2020/09/ROUGE-Lionel_Les-usages-de-la-rue…_version-longue_web.pdf