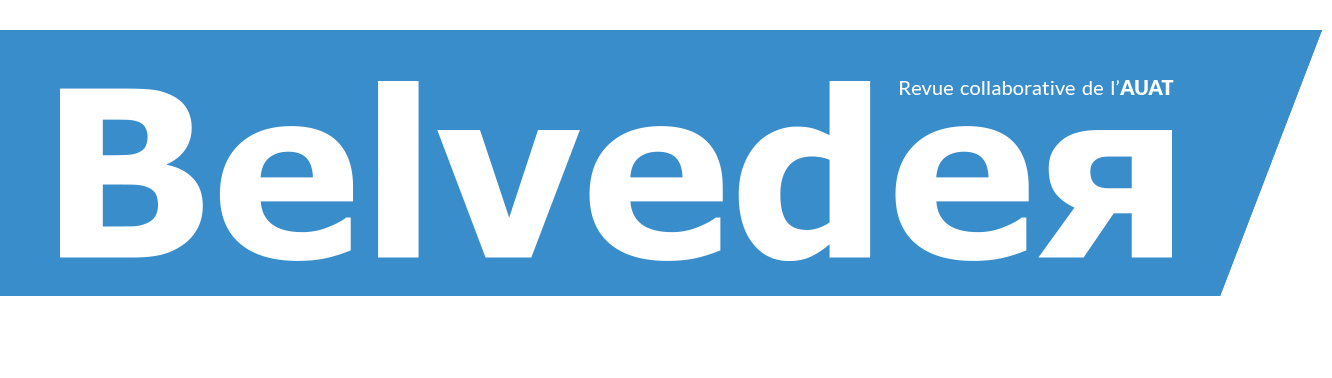Téléchargez l’article au format PDF
Morgane Perset
Chargée de mission Prospective et Dialogues urbains
AUAT
François Delarozière est le directeur artistique de la Compagnie La Machine. La Compagnie est née en 1999 à Toulouse. Après avoir ouvert un second atelier de construction à Nantes, elle s’installe dans le quartier de Montaudran en 2018 et investit pour l’occasion les rues de Toulouse avec le spectacle Le Gardien du Temple. Rencontre avec son créateur.
Vous concevez des opéras urbains dans lesquels la rue devient scène de théâtre. Pourquoi investir la rue ?
La rue m’intéresse car c’est un composant narratif de la ville. À mesure que l’on s’y déplace, de nouveaux points de vue s’offrent à nous. Quand on investit la rue pour y faire du théâtre, qu’on oublie les voitures pour y faire circuler des machines de spectacle, cela produit un effet déstructurant. On découvre un silence, on marche là où l’on n’avait pas l’habitude de marcher.
La rue est aussi un lieu de partage. Avec nos spectacles, nous allons à la rencontre des habitants. On va taper à leurs fenêtres, dialoguer avec eux à leurs balcons. On fait intrusion dans leur quotidien sans qu’ils y soient forcément préparés. Ce qui est fascinant, c’est l’effet de surprise. Dans la rue, le théâtre va à la rencontre des gens et non l’inverse. C’est une convocation par la rumeur.
Comment êtes-vous venu au théâtre de rue ?
Le paysage m’a toujours fasciné. Aux Beaux-Arts, je me suis intéressé aux performances, au land art et, très vite, j’ai travaillé dehors. J’intervenais dans des villes où j’utilisais le hasard pour créer des rendez-vous impromptus.
C’est lorsque j’ai rencontré la compagnie Royal de Luxe dans les années 1980 que je me suis ouvert au théâtre de rue. Je me suis plu à observer le paysage, à essayer de comprendre comment fonctionne l’espace public, et surtout à trouver le moment opportun pour y intervenir. Il faut aussi bien choisir sa lumière : le soleil ou les lumières de la ville. La rue est un lieu de mouvement, un lieu vivant. Au fil des années, on finit par comprendre un paysage, à le diagnostiquer.
Le point de départ de la conception de vos spectacles est-il l’histoire ou le lieu ?
Mes intuitions viennent souvent d’une confrontation au lieu. Je commence par aller à sa rencontre, je fais attention à ce que me renvoie l’espace et à son histoire. C’est à partir de cela que je crée une aventure.
Pour le spectacle Le Gardien du Temple, dès le départ je savais qu’il y aurait un grand spectacle avec une machine toulousaine et une halle pour l’exposition de l’écurie de machines. Le projet était pensé comme ça, comme un package. Le minotaure est arrivé après. C’est en revenant à Toulouse que je me suis replongé dans son histoire antique, sa proximité avec l’Espagne aussi, avec la référence du taureau : la rue Matabiau, la rue du Taur… J’ai marché dans le labyrinthe du centre-ville, avec ses rues monochromes et enchevêtrées. J’ai aussi redécouvert un lexique autour d’Icare, d’Ariane, de Dédale, du mythe de l’aérien…
Comment travaillez-vous avec les autorités et les services techniques des villes dans lesquelles se déroulent vos spectacles ?
Dans les années 1980, même si on avait une autorisation municipale, la police arrêtait le spectacle en plein milieu pour nous demander de la leur montrer avant de nous laisser redémarrer. Les choses ont évolué. Le théâtre de rue est aujourd’hui le moteur de beaucoup de festivals, c’est un enjeu économique.
Comme pour toute manifestation sur l’espace public, on monte des dossiers de demande de fermeture de routes auprès de la préfecture et de la Ville. On a une expertise assez approfondie de ces sujets, on discute de façon constructive avec les autorités pour mettre en place des systèmes qui dénaturent le moins possible le théâtre que l’on fait dans la rue.
Tous nos déplacements sont minutés, on sait précisément à quelle vitesse avancent nos machines. On propose un premier parcours aux autorités et on définit ensemble le parcours définitif, la date et l’heure. On règle ensuite les problèmes un à un. Par exemple, à Toulouse, il ne fallait pas toucher certains platanes pour éviter de propager une maladie. Donc on élague certains arbres, on enlève des feux rouges, des bornes d’accès, des décorations de Noël… Depuis quelques années, on intègre aussi la problématique de gestion des attentats. On met des plots le long du parcours pour éviter les voitures-béliers par exemple, et c’est l’objet de discussions très précises sur le positionnement de chaque plot.
Vous avez installé des « écuries » de machines sur l’Île de Nantes et dans le quartier Montaudran Aerospace à Toulouse plus récemment. Comment vos projets culturels et artistiques s’insèrent-ils dans ces projets urbains ?
Pour le projet des Machines de l’Île de Nantes, l’idée était celle d’un projet culturel fort pour structurer à la fois la nature du paysage et son imaginaire, pour l’enrichir d’une histoire artistique. Notre projet a participé à la valorisation du territoire, il a créé des pratiques, incité les habitants à passer le pont. Des gens s’y sont installés, des commerces s’y sont implantés. Ce projet est un accélérateur, tout comme celui de Montaudran où on ressent déjà la dynamique liée à l’implantation de la Halle de La Machine. La Piste des Géants est une artère empruntée et on pressent qu’elle va devenir un lieu très pratiqué. Des entreprises sont aussi venues s’installer à proximité de la Halle de La Machine, attirées par l’esprit de ville innovante et vivante. En faisant venir du public, en occupant l’espace public et en créant les conditions pour que les gens s’y réunissent, on crée de l’échange, humain et commercial aussi. C’est pourquoi il est important de donner les moyens aux artistes de participer à la construction de la ville avec les urbanistes, les architectes, les aménageurs, les collectivités !
© Jordi Bover