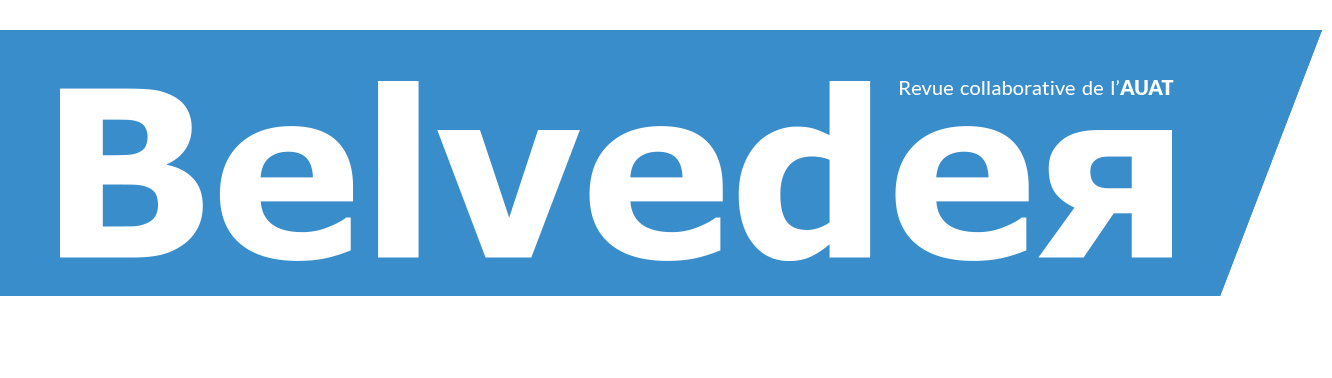Téléchargez l’article au format PDF
Robert MARCONIS
Professeur émérite, membre du LISST – CIEU
Université Toulouse II – Jean-Jaurès
Au sein d’agglomérations de plus en plus étendues et complexes, il n’est pas évident de décrypter les logiques et les principes qui sous-tendent la réalisation de projets multiples contribuant à l’extension des espaces urbanisés ou à leur renouvellement. L’apport des outils de planification n’est en effet pas simple à saisir, et le citoyen a l’impression d’un empirisme porté par une multitude d’acteurs privés et publics, aux intérêts parfois contradictoires. Les pouvoirs publics eux-mêmes, pilotes des politiques de planification, peinent à en donner une vision claire, d’autant plus que ces politiques s’inscrivent nécessairement dans un temps long, souvent sans rapport avec celui des mandats électoraux. Ont-ils d’ailleurs la maîtrise des processus à l’œuvre, dont beaucoup sont tributaires de la conjoncture économique et de ses aléas, de modifications incessantes des cadres juridiques, réglementaires et fiscaux…, auxquels s’ajoute l’évolution des pratiques des habitants, de leurs choix résidentiels et/ou de leurs déplacements ?
La planification urbaine ne serait-elle autre chose que la mise en œuvre d’arbitrages ou de compromis subtils entre intérêts particuliers et intérêt général ? Elle devrait pourtant bien, comme le rappelle P. Merlin 1, être « l’action visant à fixer, pour un territoire donné, les objectifs de développement et de localisation harmonieuse [ou rationnelle ?] – des hommes et de leurs activités, des équipements et des moyens de communication. Elle doit toujours prendre en compte les données et les contraintes naturelles, économiques et humaines et tenir compte des objectifs fixés par les responsables élus de la population, qui, en dernier ressort, auront aussi à approuver les plans établis. »
Ingénieurs et architectes, deux « cultures » au service d’une même intention : la planification
Depuis des siècles, les hommes ont créé et aménagé des villes dont l’organisation et la configuration territoriale répondaient à des fonctions multiples et aux besoins présents et futurs des systèmes productifs dominants. Pour façonner ces territoires urbains et anticiper leur croissance, pour assurer leur bon fonctionnement, deux types de compétences ont été mobilisés, « complémentaires tout en étant rivales », celles des ingénieurs et des architectes. Issus des grandes écoles, les ingénieurs, en particulier en France ceux des ponts et chaussées, ont joué un rôle prépondérant avec la révolution industrielle, « accusés par les architectes qui considéraient leurs intérêts professionnels menacés d’utiliser des matériaux vils et de manquer à la vocation esthétique de l’art d’édifier » (F. Choay) 1. Chargés de concevoir et de réaliser des immeubles ou de grands édifices monumentaux, les architectes ont eu à cœur de préserver leur indépendance et d’exercer leur art dans une logique libérale. Ils ont ainsi imprimé leur marque dans l’espace urbain à l’échelle de la parcelle, de la rue ou du quartier. Les ingénieurs, au contraire, travaillent sur des territoires plus vastes, dont ils conçoivent souvent la configuration autour de grandes opérations de génie civil façonnant l’espace public (voirie, réseaux divers, grands équipements collectifs…). Ce sont eux qui, à la demande des pouvoirs publics, chargés in fine d’approuver leurs plans, proposent les grandes lignes d’une planification spatiale.
Cette dualité renvoie à des conceptions différentes de penser et de faire la ville, l’une guidée par une logique « fonctionnaliste », l’autre plus « culturaliste » ou patrimoniale.
La dualité ingénieurs/architectes à travers leur relation avec les administrations centrales de l’État
Lors de la grande phase d’urbanisation des années 1960, prenant acte de leur différence, la direction de l’Architecture fut placée sous la tutelle du ministère de la Culture, alors que les ingénieurs relevaient des directions des travaux publics et de la construction, intégrées en 1966 dans un grand ministère de l’Équipement. Puis, en 1978, leur regroupement au sein d’un même ministère pléthorique et ambitieux « de l’Environnement et du Cadre de vie » fut révélateur de conflits majeurs. Dès 1981, c’est la logique des ingénieurs, celle de l’Équipement, qui l’emporta. Dotée de nouveaux cadres, en particulier avec la mise en place d’un véritable enseignement supérieur pour la formation des architectes, portée par une politique de grands travaux et de grands noms de la profession, la direction de l’Architecture revint, en 1995, dans le giron de la Culture ! Tirant les leçons de cette réforme, M. de Saint-Pulgent 2 estime que « la réunion des cultures des architectes et des ingénieurs au sein du ministère de l’Équipement était une fausse bonne idée, qui a favorisé leur confrontation et non pas leur dialogue. La qualité de l’urbanisme est une préoccupation qui doit être partagée par tous, ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage et autres aménageurs mais ne saurait fonder un métier à part entière. » S’expliquent ainsi en France l’émergence désordonnée et une reconnaissance tardive d’une pratique nouvelle, celle de l’urbanisme.
La nécessité d’une convergence entre les plans des ingénieurs et des architectes a pourtant été ressentie très tôt, dès le milieu du XIXe siècle. Pour les plus grandes villes (Barcelone, Paris, Londres…) c’est en fait l’ensemble de leur organisation territoriale qu’il convenait alors de repenser. Dépassant et englobant celle des ingénieurs et des architectes, en leur associant d’autres acteurs dans une démarche prospective, cette vision globale appelait une pratique nouvelle, celle de l’urbanisme, terme qui ne fut reconnu qu’au début du XXe siècle.
De l’urbanisme à la planification territoriale
Nourri par son expérience acquise lors de la réalisation du plan d’extension de Barcelone, Cerdá (1815-1876) avait proposé de donner le statut de science à l’urbanisme, « aménagement concerté de l’espace d’un grand territoire urbain » 3.
Cette préoccupation avait été celle des travaux d’Haussmann. Associant ingénieurs et architectes aux grands intérêts du capitalisme conquérant (sociétés immobilières et commerciales, banques, compagnies de chemins de fer…) sous la houlette de l’État, le « modèle haussmannien » et ses percées se diffusèrent ensuite dans les grandes villes de province 4. Limités à la Ville de Paris, après l’annexion des communes limitrophes en 1860 qui doubla sa superficie, ces grands travaux concernaient essentiellement le cœur d’une agglomération, dont la croissance se développa ensuite bien au-delà avec l’apparition de « banlieues » constituées de « lotissements » souvent dépourvus d’équipements collectifs. Pour éviter que la « question sociale » induite par ce type d’occupation de l’espace ne favorise une contestation violente de l’ordre établi, soucieux d’hygiénisme et du bien-être de ces populations de « mal-lotis », élus et philanthropes proposèrent de mettre en œuvre une politique visant à maîtriser le devenir d’une multitude de communes périphériques, pour accompagner l’urbanisation qui les submergeait (logements, voirie, assainissement, alimentation en eau…). Mais cela supposait l’intervention du législateur et la promotion d’un « droit de l’urbanisme » qui s’imposa très lentement, car il portait atteinte à un héritage majeur de la Révolution, la propriété privée du sol, « droit inaliénable et sacré ». La puissance publique se montrait réticente à légiférer, car les propriétaires fonciers et immobiliers y voyaient une atteinte à leurs droits (obligation du permis de construire en 1903) ou une concurrence déloyale de la part des pouvoirs publics, lorsque la loi Bonnevay (1912) autorisa les collectivités locales à financer des logements sociaux. Le développement anarchique et l’insalubrité des lotissements de banlieues encouragèrent cependant le législateur à proposer des moyens de planifier et de contrôler l’urbanisation. Il y a cent ans, la loi Cornudet (1919, révisée en 1924) fut l’acte de naissance en France d’une politique de planification urbaine, prescrivant pour toutes les villes de plus de 10 000 habitants un « projet d’embellissement et d’extension » 5. Il s’agissait là d’un travail considérable, du fait de la diversité des intérêts concernés, qui appelait le recours à des compétences variées et complémentaires, dépassant celles des seuls ingénieurs et des architectes, qui s’investirent dans ce nouveau champ de l’urbanisme pour proposer leurs services. La mise en œuvre de la loi Cornudet fut laborieuse, mais servit de laboratoire pour définir des pratiques nouvelles en matière d’urbanisme. En ce domaine, tout était à inventer ou presque, autour de démarches faisant appel à des disciplines diverses, (histoire, géographie, sociologie, sciences politiques, droit…). Mais la question majeure était celle des périmètres de planification lorsque les projets concernaient une véritable région urbaine en formation.
L’urbanisme devient discipline
Les militants de l’urbanisme obtinrent la création d’un enseignement spécifique d’urbanisme, confié en 1924 à l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris, associant professionnels, enseignement supérieur et recherche scientifique. 415 thèses y furent soutenues jusqu’en 1968, tandis qu’une revue spécialisée, La Vie urbaine, assurait la diffusion de ces savoirs.
Zoom sur…
Vers des outils dédiés
Après plusieurs exercices (plan Prost de 1939, Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région parisienne de 1960), le Schéma directeur de la région de Paris, présenté dès 1964, fut un formidable laboratoire qui permit de tester en vraie grandeur certaines procédures, de nouvelles formes urbaines et des modèles d’urbanisation comme les villes nouvelles. Dès 1967, la loi d’orientation foncière en tirait les leçons avec la généralisation, pour les grandes villes de province, de nouveaux documents d’urbanisme régulant l’utilisation des sols (POS) et préparant des outils de planification spatiale à l’échelle intercommunale (SDAU). Les grandes métropoles de province, dont les huit métropoles d’équilibre désignées par la DATAR, devaient en effet relever le défi que leurs imposait l’accueil de nouveaux habitants, d’équipements majeurs à vocation régionale et d’activités induites par la croissance économique nationale, dont certaines « décentralisées » depuis la capitale. Pour chacune, le « modèle parisien » les invitait à repenser leur organisation territoriale entre centres anciens, dont il fallait redéfinir la fonction, et périphéries qui pouvaient accueillir de vraies villes nouvelles fonctionnelles (Lille-Est, L’Isle-d’Abeau, Le Mirail…), rompant avec le modèle de plus en plus contesté des « grands ensembles » et des ZUP de la décennie précédente. Dans un pays encore très centralisé, c’est l’État et ses services déconcentrés, où les ingénieurs jouaient toujours un rôle majeur, qui ont piloté les nouvelles règles de l’urbanisme, retrouvant sur le terrain des partenaires architectes ou promoteurs, qui avaient acquis des compétences nouvelles en Île-de-France ou dans de grands aménagements, comme les stations nouvelles du littoral languedocien. Face à eux, les collectivités territoriales avaient alors des compétences et des moyens financiers encore limités, même lorsqu’elles se dotaient d’outils nouveaux, comme les ateliers municipaux d’urbanisme ou les agences d’urbanisme 6, dont beaucoup de cadres étaient issus des grands corps d’ingénieurs. Rares sont les collectivités (Montpellier ?) qui sont parvenues, dans un premier temps, à se démarquer des modèles dominants.
Des SDAU aux SCoT : le rôle des collectivités territoriales
La décentralisation, la fin des Trente Glorieuses, le désengagement progressif de l’État… ont-ils remis en cause ces logiques héritées d’une longue histoire ?
La donne a fondamentalement changé. Au moment où la circulaire Guichard mettait fin aux grands ensembles (1973), la politique du logement et la production industrialisée de la maison individuelle ont ouvert la porte à une nouvelle forme d’urbanisation qui a déferlé dans les campagnes, de plus en plus loin des agglomérations identifiées par la continuité du bâti. Elle allait de pair avec l’usage généralisé de l’automobile pour les déplacements quotidiens dans les « couronnes périurbaines ». Et cela au moment où la décentralisation accordait des compétences nouvelles aux collectivités territoriales. Chaque recensement a permis de mesurer l’ampleur de cet « étalement urbain », imposant à l’INSEE de redéfinir ses zonages. La réalité de l’urbanisation est désormais celle des aires urbaines. Comment l’intégrer dans des périmètres institutionnels en utilisant les possibilités ouvertes par les lois sur l’intercommunalité ? Comment la prendre en compte dans la redéfinition des anciens SDAU, tout en prenant en compte les enjeux patrimoniaux, environnementaux et la question du développement durable ? La loi SRU (2000) et le(s) « Grenelle de l’environnement » (2007-2009) ont permis de faire émerger un consensus autour des objectifs de « solidarité » et de « renouvellement », afin d’enrayer l’étalement urbain, par le biais, notamment, d’une meilleure articulation entre urbanisme et transports.
Les documents d’urbanisme ont été repensés en conséquence, dans un cadre intercommunal devenu impératif, mais dont la configuration territoriale pertinente reste difficile à définir : l’État n’ayant plus un rôle de coercition, la décision appartient aux collectivités territoriales, qui ne peuvent ignorer les enjeux de pouvoir et la pression des groupes d’intérêts. Les documents d’urbanisme destinés à planifier les villes et leur développement sont devenus plus contraignants : les SCoT ont remplacé les SDAU avec des périmètres souvent élargis, et les POS sont devenus des PLU puis des PLU intercommunaux (PLUi) qui fixent les règles d’utilisation du sol et parfois la programmation de l’habitat ou des déplacements quand ils sont PLUi-H ou HD… Quant aux régions, suite à la loi NOTRe d’août 2015, elles doivent désormais élaborer des SRADDET.
Revenir sur certains quartiers nés de la planification urbaine des années passées
Dès les années 1970, les questions sociales étaient devenues majeures, concentrées dans certains quartiers hérités de l’urbanisme collectif des décennies précédentes : chômage, précarité, immigration… Pour traiter de ces questions, l’État a mis en place une « politique de la ville » 7, 8 qui a permis un traitement spécifique de ces « zones urbaines sensibles ». Le chemin a été long, semé d’embûches, jusqu’à l’affirmation d’une politique de « rénovation urbaine » dotée de cadres juridiques et de moyens importants avec la création de l’ANRU (2004).
Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces politiques, le millefeuille institutionnel est devenu de plus en plus complexe, ce qui accroît la perplexité du citoyen face à des processus de décision qui concernent directement le développement et l’organisation de son cadre de vie actuel et futur. Tout cela demande du temps, se co-construit et se négocie par le biais de partenariats à géométrie variable, associant l’État, les différentes strates de collectivités territoriales et tous les acteurs privés qui « font la ville » et sont soumis aux règles de l’économie de marché 9. L’enjeu est aussi de clarifier les liens entre les documents de planification à portée réglementaire ou élaborés aux différentes échelles territoriales, leur opposabilité, la mise en compatibilité les uns avec les autres… ce que la loi ELAN de novembre 2018 se propose de faire par ordonnance d’ici 2021.
Un dess(e)in pour le territoire
Le temps n’est plus où le jeu urbain associait ou opposait ingénieurs et architectes. Leurs compétences demeurent essentielles, mais désormais sollicitées dans des cadres beaucoup plus divers, afin de trouver à l’échelle de chaque territoire des solutions plus spécifiques qui s’affranchissent des grands « modèles » urbanistiques longtemps imposés au plan national par les grands corps de l’État. En ces domaines, les collectivités locales et leurs groupements jouent un rôle majeur, s’efforçant d’élaborer des « projets de territoire » innovants en constituant leurs propres équipes de techniciens, tout en veillant à leur acceptabilité sociale, car la sanction électorale demeure l’une de leurs préoccupations majeures. Les grands projets d’aménagement, portés par des exercices de planification réglementaire ou des projets territoriaux stratégiques, se construisent dans le temps long, et leur pérennité, au-delà des changements de majorités politiques, passe par la quête de consensus. Cela suppose d’y associer étroitement les citoyens, selon des procédures de concertation dont l’éventail n’a cessé de s’élargir. Mais en matière d’urbanisme, s’exprimant au nom de la « société civile », les citoyens et leurs « associations » ont-ils toujours raison ? Dans une démocratie représentative, les choix majeurs incombent in fine aux élus, qui arbitrent entre divers projets, portés par des équipes techniques mobilisant une grande diversité de compétences, ce qui conduit peut-être à repenser la composition des assemblées délibérantes, dans les grandes intercommunalités en particulier.
Les projets métropolitains, vers un renouvellement de la planification spatiale ?
Depuis la fin du XXe siècle, certaines métropoles européennes font appel à des équipes d’architectes-urbanistes, souvent de renom, pour les accompagner dans la définition de leur projet de territoire. Ces démarches prennent la forme de visions ou récits territoriaux tout en s’attachant aussi à quelques sites majeurs comme lieux de projets. Il s’agit de dépasser l’approche uniquement spatiale pour articuler dessein et dessin, en croisant les approches (sociale, économique, paysagère), en intégrant l’ensemble du territoire, en articulant la ville périphérique, les tissus hétérogènes, les fragments de la ville…
Ces démarches se distinguent généralement des exercices formels de planification territoriale sur la forme, puisqu’elles procèdent d’engagements volontaires des collectivités, mais surtout sur le fond, car elles proposent des visions contrastées du devenir possible ou souhaitable du territoire. Il s’agit moins de travaux visant à équiper et bâtir un territoire pour faire face à la croissance urbaine et en assurer la modernisation, que de prospectives ouvertes, permettant d’intégrer le caractère imprévisible de l’avenir et de nourrir le débat. Les deux types d’exercices sont aujourd’hui de plus en plus souvent amenés à dialoguer. Depuis la loi SRU (PLU-SCoT) qui instaure le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) par exemple, le projet territorial ou métropolitain est présumé tenir compte du PADD, ou venir l’alimenter, selon la temporalité des exercices.
- MERLIN P., CHOAY F., Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, Quadrige, 2005.
- LENGEREAU É., Architecture, urbanisme et pratiques de l’État, 1960-2010, La Documentation française, 2017.
- CERDÁ I., La Théorie générale de l’urbanisation (1867), Les éditions de l’imprimeur, traduction française, 2005.
- PINON P., Atlas du Paris haussmannien, Parigramme, 2002.
- DEMOUVEAUX J.-P., LEBRETON J.-P., La Naissance du droit de l’urbanisme, (1919-1935), Éditions des Journaux officiels, 2007.
- « Les agences d’urbanisme en France », Territoire en Mouvement, 2007.
- JAZOULI A., REY H., Pour une histoire de la politique de la ville, Éditions de l’Aube, 2015.
- « Quarante ans de politique de la Ville », Urbanisme, hors-série 62, 2017.
- HURÉ M. et al., (Re) penser les politiques urbaines, Retour sur vingt ans d’action publique dans les villes françaises (1995-2015), PUCA, « Recherche », 2018.
Contenu additionnel :