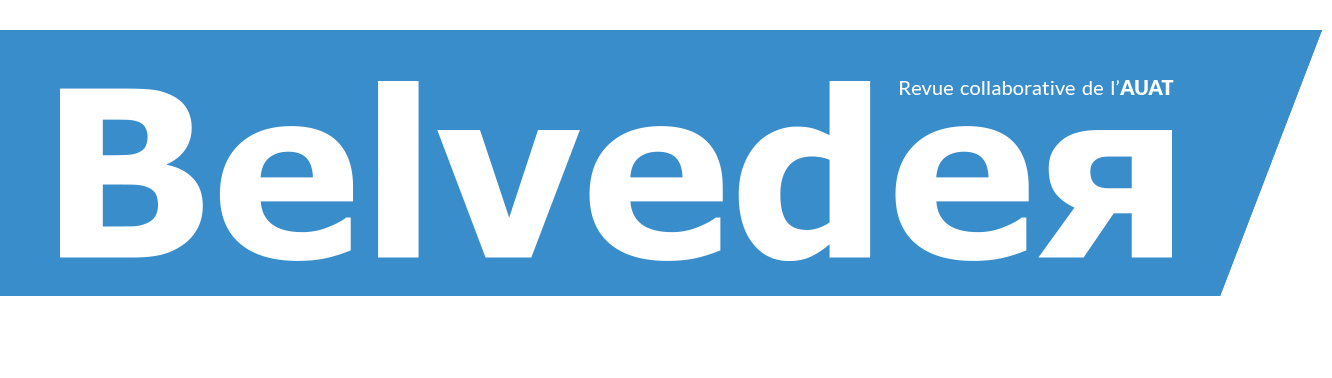Téléchargez l’article au format PDF
Emmanuel NEGRIER
Directeur de recherche CNRS au Centre d’Études Politiques Et sociaLes (CEPEL), Université de Montpellier
Comment les intercommunalités se saisissent-elles de la compétence culturelle ? Des réalités multiples sont observables en matière de contenus, de responsabilités, mais aussi d’effort budgétaire. La question est d’autant plus intéressante à l’échelle des métropoles qui revendiquent la culture comme levier d’attractivité et de distinction métropolitaine. Décryptage à l’échelle des grandes métropoles françaises.
En 1999, en préparant ce qui deviendrait la grande loi sur l’intercommunalité du 12 juillet, le cabinet de Jean-Pierre Chevènement ne pariait pas un kopeck sur la culture. C’est la raison pour laquelle l’intervention des EPCI dans ce domaine a fait l’objet d’une double limite. La première a été de la définir comme optionnelle. La compétence culturelle ne fait pas partie des obligations, comme le sont par exemple certaines responsabilités infrastructurelles ou urbanistiques (transports, logement). La seconde a été de faire dépendre l’extension des compétences culturelles d’une définition (limitative) de leur « intérêt communautaire ». Aussi, quelle ne fut pas la surprise des analystes et décideurs lorsqu’ils réalisèrent que la culture avait bel et bien pris sa place dans la liste des objets intercommunaux légitimes !
Non seulement l’option a été retenue très souvent (à plus des deux tiers des EPCI), mais encore elle a été complétée par des vocations culturelles au titre de compétences facultatives. Ce n’est pas dire que le phénomène est irrésistible. En effet, derrière la déclaration d’intérêt et donc de compétence, des distinctions considérables apparaissent d’un territoire à l’autre. Par exemple, le contenu de ce qui est inscrit au titre de la culture est très variable.
Si les domaines à réseaux d’équipements (lecture publique, enseignement musical) sont plus fréquents que les événements ou lieux patrimoniaux ou de spectacle, le type de responsabilité est lui-même variable : de la substitution totale à la commune à la simple délégation des réseaux informatiques, en passant par la seule animation culturelle des lieux. Ensuite, l’effort culturel (soit la part de la culture dans le budget total de l’EPCI) ou cet effort mesuré par habitant reste très hétérogène. Un relatif petit nombre d’intercommunalités, dont le transfert vers la communauté, urbaine ou rurale, se révèle particulièrement dynamique, cache une majorité d’EPCI qui n’entrent en culture que modestement, et presque à reculons. C’est qu’ici la perception de l’intérêt d’une politique culturelle n’est ni nécessairement partagée dans les mêmes termes ni avec la même intensité par les élus d’un périmètre intercommunal.
Cela s’est vu en particulier à l’occasion des fusions d’intercommunalités : certaines des fiancées avaient cette ambition, d’autres non. Leur mariage s’est donc souvent traduit par un divorce d’avec la compétence culturelle, réacheminée vers le niveau municipal. Ces constats sont aussi vrais globalement que pour le cercle resserré des métropoles. Avec un paradoxe évident : alors que la culture est revendiquée comme un élément de distinction métropolitaine dans un contexte de compétition interterritoriale, en raison de son pouvoir d’attractivité joyeuse, de rayonnement sympathique, elle reste rarement une des compétences majeures de la métropole. Dans un récent ouvrage, nous avons comparé l’ensemble des institutions métropolitaines à cet égard [1].
La culture représente moins de 3 % de leurs dépenses totales, soit largement moins que leurs villes-centres, autour de 10 % voire beaucoup plus. On peut distinguer quatre types de métropole culturelle.
La métropole virtuelle (Nice, Dijon, Bordeaux, Tours, Aix-Marseille, Grenoble) désigne les cas d’absence de réel transfert de politique culturelle, ni en général, ni dans la singularité de tel ou tel secteur. On peut y trouver des équipements, parfois prestigieux comme à Grenoble, des projets, des discours. Mais peu de matérialisation, voire aucune.
La métropole sélective (Strasbourg, Lille, Lyon, Paris, Nantes, Nancy, Saint-Étienne, Rennes) désigne la situation la plus fréquente, où la nouvelle institution s’est vu affecter une gestion partielle d’un ou plusieurs domaines jusque-là de compétence municipale. La compétence métropolitaine a fait l’objet d’un débat, parfois ancien, et s’est soldée par une spécialisation de l’EPCI sur un sous-secteur particulier : un grand équipement, un réseau de lecture publique, une approche patrimoniale. Mais l’expectative demeure sur le fait que ces premiers transferts soient de bons leviers pour un vrai changement d’échelle. La métropole pèse ici entre 22 % et 37 % du total des dépenses culturelles.
Le virage métropolitain (Toulouse, Brest, Metz, Rouen) concerne des espaces où, par l’intensité des transferts ou bien par le renforcement de capacité de pilotage administratif, la métropole devient un acteur central du jeu culturel. Elle le fait par des équipements, mais aussi par le fait qu’elle représente, plus que les villes, un horizon d’attente. Celui-ci n’est pas seulement budgétaire. Il touche aussi à de nouvelles pistes pour la culture, comme à Toulouse, où les nouveaux territoires de l’art, la culture scientifique et technique voisinent avec la gestion de l’Opéra Orchestre. Elle pèse, dans ce groupe, entre 44 % et 72 % du total.
La politique culturelle métropolitaine (Toulon, Montpellier, Clermont) témoigne d’un basculement réalisé. Il va souvent de pair avec une mutualisation des niveaux et des mandats politiques. Historiquement, Montpellier s’était imposée comme l’une des agglomérations très investies dans la culture. Elle le confirme au stade métropolitain, en poursuivant sa dynamique d’intégration de nouvelles compétences, d’une part, et en procédant à une mutualisation poussée des équipes et politiques, d’autre part. Deux autres cas, Clermont et Toulon, peuvent être également mentionnés comme les rares exemples de transfert du centre de gravité d’une politique culturelle de la ville vers la métropole, celle-ci représentant plus de 80 % des dépenses.
Secteur en transition, la culture à l’heure métropolitaine fait émerger trois facteurs typiques de ce type de conjoncture. Le temps est le premier, qui montre que de tels changements ont une importance symbolique telle qu’ils ne peuvent être décrétés à la seule aune de l’intérêt financier ou managérial. Les métropoles les plus intégratrices sont parmi celles qui ont commencé tôt.
Le deuxième facteur est politique, et concerne en particulier la nature du leadership multiniveau. Le dynamisme montpelliérain est fonction d’une identité de majorité entre ville et métropole que l’on retrouve, non par hasard, à Clermont, Toulon et Rouen. La stabilité du jeu lillois a à voir avec l’opposition entre ces deux échelles, qui explique la faiblesse des transferts d’équipement à Aix-Marseille, par exemple.
Enfin le troisième facteur est l’aptitude à « jouer métropolitain » chez les acteurs culturels euxmêmes. Les acteurs les plus coopératifs (lectures publiques, enseignements artistiques) sont souvent les mieux servis par le changement d’échelle, dont se protègent ceux qui sont, dans le spectacle vivant par exemple, plutôt mus par une éthique de la singularité artistique et du circuit court avec le Prince.
Pour jouer métropolitain, il faut donc cultiver un sens des liens et des patrons qui se révèlent plus subtils et complexes que ce qu’en édicte la loi.
[1] NÉGRIER E. et TEILLET P., Culture et Métropole. Une trajectoire montpelliéraine, Autrement, 2021.