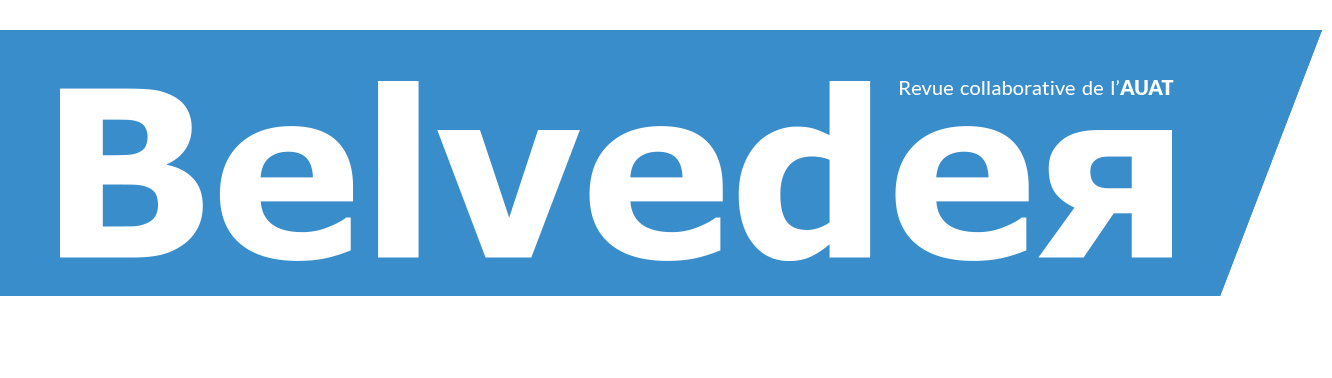Téléchargez l’article au format PDF
Christian GOLLIER
Économiste, Directeur général, Toulouse School of Economics
Les travaux de Christian Gollier s’intéressent à l’économie du risque, de l’incertain et de l’environnement. Il a à ce titre contribué aux 4e et 5e rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC, 2007 et 2013). Fervent défenseur de la taxe carbone, il considère que la fixation d’une valeur carbone serait le reflet de nos responsabilités envers les générations futures, et que cette mesure serait la plus à même de concilier lutte contre le changement climatique et besoins économiques.
Les récits actuels autour de la décarbonation prônent l’idée d’une transition énergétique heureuse. À contrepied, vous portez de votre côté un discours que vous voulez pragmatique, celui d’une décarbonation coûteuse et qui se fera avec « du sang, des larmes et de la sueur ». Comment expliquez-vous ces deux discours diamétralement opposés sur la décarbonation ?
Nous sommes encore aujourd’hui dans l’utopie d’une transition énergétique heureuse. Or, pour décarboner, nous allons devoir nous imposer une transition énergétique majeure dans les 25 prochaines années. C’est-à-dire nous tourner vers d’autres sources d’énergie qui sont aujourd’hui plus coûteuses et plus difficiles à mettre en œuvre. Il va donc falloir mener une transition extraordinaire qui nécessitera des transformations en profondeur de nos modes de production, de consommation, de nos modes de vie.
Il n’y a pas de solution simple et, en l’absence de révolutions technologiques majeures, la décarbonation sera coûteuse. On sait par exemple que les bâtiments les mieux isolés coûtent plus cher à produire, qu’une voiture électrique coûte plus cher qu’une voiture thermique… On ne sait pas, par contre, quel sera le coût des matières premières dans 25 ans. Il est encore compliqué aujourd’hui de produire des sources d’énergie décarbonées et il n’y a pas de consensus sur l’orientation des investissements dans l’hydrogène, les batteries ou l’électricité verte. Les incertitudes technologiques sont donc majeures. C’est un problème car nous ne sommes pas sûrs de « parier sur le bon cheval ». Des industries pourraient disparaître. Les marchés et les banques centrales s’inquiètent déjà car des pans de nos économies pourraient devenir des « actifs échoués » si l’on ne réussit pas à les décarboner.
La décarbonation sera donc coûteuse, mais il faut rappeler que son coût est bien inférieur à celui de l’inaction. In fine, les gens devront donc payer et c’est en cela que la décarbonation ne sera pas heureuse. Il y a bien entendu des solutions moins incertaines et moins coûteuses que d’autres, des solutions basées sur la sobriété. La décroissance est sans doute le chemin de la décarbonation le moins incertain. Mais est-ce le plus désirable ? Aussi, tant que la majorité des citoyens croit en l’utopie d’une transition énergétique heureuse, ces mêmes citoyens soutiendront l’inaction climatique. Pour autant, en France, nous sommes bien informés de la situation et conscients de notre responsabilité en matière d’émission de carbone. « Du sang, des larmes, de la sueur », j’ai conscience que c’est un discours difficile à porter, notamment politiquement, mais il me semble que c’est ce qui est devant nous.
À défaut d’une décarbonation heureuse, des mécanismes financiers peuvent-ils permettre une décarbonation équitable ? Vous défendez l’idée d’une réforme du prix du carbone. Cela est-il compatible avec l’idée d’une décarbonation acceptable pour les ménages les plus modestes ?
La politique climatique a un impact sur la distribution des richesses. Les 10 % des ménages les plus riches ont une demande d’énergie huit fois plus élevée que celle des ménages les plus modestes. Pour autant, ces derniers y consacrent une part plus importante de leur budget.
L’augmentation des prix de l’énergie aurait donc un impact plus fort sur les ménages les plus modestes. On pourrait aussi augmenter la dette de l’État, mais ce seraient les citoyens de demain qui auraient à leur charge de la rembourser. Par contre, une taxe carbone engendrerait un revenu fiscal permettant de compenser les ménages les plus modestes par le biais d’une redistribution. Bien sûr, l’assiette de cette taxe est in fine vouée à disparaître. Pour autant, tant que l’on est sûr de ce revenu, il est possible de compenser, voire de surcompenser les ménages les plus modestes. L’État est suffisamment puissant pour introduire une réforme des prix et ainsi inciter tous les agents économiques à réaligner les intérêts privés sur l’intérêt général. Il n’existe pas dans l’histoire de l’humanité d’évolution de l’envergure de la transition écologique et énergétique qui ne se soit faite sans transition des prix.
Quels sont les raisons de l’inaction des décideurs, des producteurs, des consommateurs de carbone ? Vous mobilisez les images de « passager clandestin », de « tragédie des horizons » et de « fuite de carbone » à ce sujet. Pouvez-vous nous les expliquer ?
J’identifie en effet trois grandes raisons de l’inaction. La première, c’est que le problème climatique est celui d’une externalité globale, où ceux qui font des efforts en supportent 100 % des coûts mais n’en tirent qu’une infime partie des bénéfices. Chaque pays a donc intérêt à jouer la stratégie du « passager clandestin », attendant que les autres sauvent la planète. Mais in fine, l’humanité fonce dans le mur en appuyant sur l’accélérateur. Il faut aussi dire que le manque d’ambition de l’accord de Paris et les doutes forts sur la crédibilité des engagements qui y sont consignés n’encouragent guère à l’action. Dans toutes les universités du monde, les économistes enseignent que la solution au problème du passager clandestin est l’application du principe « pollueur-payeur ». Dans cet esprit, la plupart d’entre eux militent depuis des années pour un prix universel du carbone, unique et mondial.
S’ajoute à cela la « tragédie des horizons ». Le cycle du carbone dans l’atmosphère et dans la biosphère est très lent. Ainsi, quand vous émettez du carbone, il reste pendant des siècles dans l’atmosphère. De la même manière, même si l’on arrête aujourd’hui d’émettre du carbone, on connaîtra quand même une augmentation des températures à court terme. Il y a donc peu de bénéfices immédiats à la baisse de nos émissions de carbone. Elles serviront aux générations futures. Malheureusement, l’être humain est court-termiste. Il est compliqué de l’inciter à faire des choses qui auront un impact pour les générations futures.
La troisième raison de l’inaction, c’est le problème des fuites de carbone. Parmi les mesures mises en place par les États pour baisser leurs émissions de carbone, certaines reposent sur le principe de pollueur-payeur associé au respect de normes de décarbonation. Cela n’entraîne en fait pas tant une baisse des émissions que le déplacement de ces émissions. Prenons l’exemple de l’acier. Avec des mesures de type pollueur-payeur mises en place par les États européens, les coûts de production de l’acier en Europe augmentent et les industries délocalisent leur production. En définitive, les bénéfices seront nuls car on aura déplacé les émissions de carbone de l’Europe vers des pays moins-disants en matière de transition énergétique et écologique. Il apparaît ainsi qu’une bonne partie des 25 % de réduction des émissions de carbone de l’Europe depuis les années 1970 proviennent en fait du report vers la Chine.
L’adaptation au changement climatique a longtemps été un sujet tabou en économie. Parler d’adaptation revenait à accepter un échec. Mais aujourd’hui, la vitesse du changement climatique est telle que l’on parle bien d’adaptation en économie. Pour réduire nos émissions de carbone de 55 % à l’échelle européenne d’ici à 2030, la marche est haute. Il faut un gouvernement fort pour imposer un prix du carbone tout en compensant les ménages les plus modestes. Il faut aussi valoriser les comportementaux vertueux.
Entretien réalisé par Morgane Perset, Rédactrice en cheffe de BelvedeR.
© John Hanson Pye - Alamy banque d’images